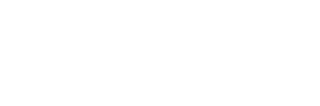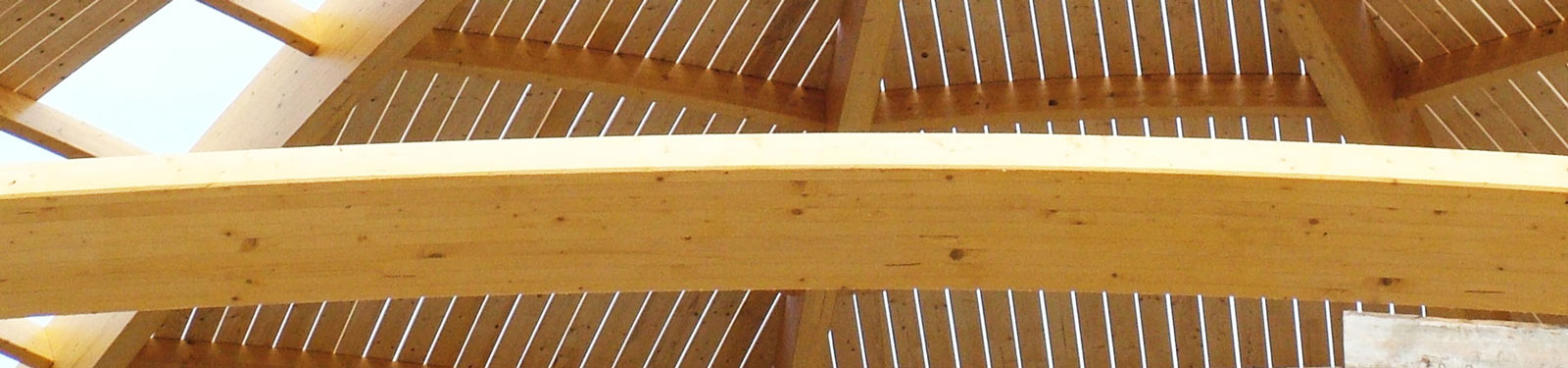FAQ (Questions – Réponses)
-
Les terrasses de toit en bois peuvent-elles répondre à l’exigence incendie Broof(t1) ?
Dans les annexes 5/1 et 6 de l’Arrêté Royal du 7 juillet 1994 fixant les normes en matière de prévention contre l’incendie, il est mentionné que les produits de couverture pour toitures doivent répondre à la classe d’incendie Broof(t1), respectivement pour les nouveaux bâtiments (aussi bien pour les bâtiments bas que pour les bâtiments moyens et hauts) ainsi que pour les bâtiments industriels. Les habitations unifamiliales sont exemptées des ces exigences incendie. Les terrasses de toit en bois ne sont pas spécifiquement prévues dans cette réglementation, ce qui veut dire que le comportement au feu de la terrasse de toit en bois doit être fixé expérimentalement selon la norme d’essai NBN CEN TS 1187 (2013) « Méthodes d’essai pour l’exposition des toitures à un feu extérieur. »
La classe d’incendie Broof(t1) fait référence aux performances au feu d’une structure de toit exposée à un foyer d’incendie extérieur (voir norme NBN EN 13501-5). Une structure de toit conforme empêchera que l’incendie se propage à travers le toit (formation de foyers d’incendie secondaires), ou que le toit soit perforé par l’incendie de sorte que la sous-structure puisse également prendre feu.
Dans le passé, des essais incendie sur des terrasses de toit en bois ont été effectués selon la norme susmentionnée à la demande du SPF Intérieur, avec plusieurs essences et dispositions. Avec l’emploi d’essence de masse volumique élevée (supérieure à 750kg/m³), il ressort que les dégâts se limitent à la zone sous le brandon enflammé (panier rempli de laine de bois). Aucune propagation du feu n’a été observée.
Une terrasse de toit en bois répondra donc à la classe d’incendie Broof(t1) si les points suivants sont satisfaits :
– La masse volumique de l’essence doit être supérieure à 750kg/m³. Vous pouvez facilement retrouver la masse volumique d’un grand nombre d’essences via le lien Les essences.
– La structure du toit sous la terrasse en bois répond à Broof(t1).Si une essence appropriée est donc choisie, cette exigence incendie pourra relativement facilement être satisfaite !
-
L’emploi de la créosote comme substance de préservation des bois est-il toujours permis ?
La créosote est classée comme produit cancérogène et est considérée comme substance très persistante, très bioaccumulable et toxique.
L’emploi de la créosote est interdit dans la majorité des usages et n’est plus en vente libre destinée au particulier. Bien qu’il existe d’autres alternatives de produits de traitement biocides, une période de test de ces produits est encore nécessaire afin de s’assurer de leur efficacité totale pour tous les usages auxquels les bois créosotés sont encore employés. Il s’agit exclusivement des traverses de chemin de fer en bois ainsi que des poteaux électriques et de télécommunications.
Ces emplois se justifient encore pour des raisons techniques : le poids léger des bois créosotés par rapport à celui des autres matériaux, la facilité d’entretien, la durée de vie élevée, l’emploi d’un matériau durable, le prix avantageux, … En effet, les alternatives aux traverses et poteaux en bois traités restent sujettes à essais mais leur durée de vie est aussi souvent plus réduite et leur coût souvent supérieur.
Bien que les risques des produits créosotés pour la santé humaine soient réels surtout pour les travailleurs en station de traitement mais également pour les installateurs et le grand public exposé, la Commission Européenne a pris la décision, le 14/10/2022, de renouveler l’approbation de la créosote en vue de son utilisation en traverses de chemin de fer et poteaux électrique et de télécommunication sous réserve de certaines conditions (entre autres par des prises de mesures d’atténuation des risques pour les personnes les plus exposées) et durant une période qui n’excède pas 7 ans. La Commission estime que les conséquences négatives d’une interdiction totale et définitive de la créosote seraient disproportionnées pour la société par rapport aux risques résultant de l’utilisation de la créosote pour les traverses de chemin de fer ainsi que les poteaux électriques et de télécommunication.
Les opérateurs économiques auront ainsi suffisamment de temps pour s’adapter à la future disparition, vraisemblablement inéluctable, de la créosote durant cette phase de transition.
-
Est-il nécessaire d’apporter un traitement de préservation pour un bardage extérieur en Douglas ?
De nombreux consommateurs s’interrogent sur le traitement des bardages en bois. Voici la réponse de notre spécialiste concernant les bardages extérieurs en Douglas.
De manière générale, les espèces dont la classe de durabilité naturelle est supérieure à 3 conviennent parfaitement pour une mise en œuvre en bardage, sans traitement de préservation préalable du bois. Cela signifie donc que les classes de durabilité 1 (la plus résistante), 2 et 3 sont idéales pour un bardage extérieur.
Douglas sans aubier
Etant donné que le Douglas appartient à la classe de durabilité naturelle 3, si les lames de Douglas ne comportent pas d’aubier (l’aubier n’est jamais durable, il est de classe de durabilité 5), le traitement des lames n’est pas nécessaire pour un bardage extérieur à condition de respecter les règles de mise en œuvre renseignées dans la NIT 243 (publiée en décembre 2011 par le CSTC et intitulée « Les revêtements de façade en bois et en panneaux à base de bois ») relatives à la lame de ventilation, aux ouvertures de ventilation, aux fixations…. Dans le cas du Douglas, l’aubier est aisément distinguable car de couleur blanche par rapport au duramen qui est orangé.
Cela signifie que dans la pire des situations, c’est-à-dire en contact avec le sol, sa durée de vie attendue est de l’ordre de 10 à 15 ans. Mais rassurez-vous, le bardage est toujours dans une situation plus favorable à celle du contact avec le sol ! On peut donc attendre une durée de vie nettement plus importante. Les critères normatifs n’établissent des durées de vie que pour des situations où le bois est en contact avec le sol. Il est donc impossible de se positionner sur la durée de vie d’un bardage. Théoriquement, si le bois ne reste pas humide (c’est-à-dire avec un taux d’humidité du bois supérieur à 20% durant une longue période), sa durée de vie est infinie !
Vous pouvez donc le poser sans le traiter s’il ne contient pas d’aubier et il grisaillera plus ou moins rapidement en fonction de son orientation (sud sud-ouest étant la moins favorable au maintien de la couleur initiale du bois).
Douglas avec aubier
Si les lames contiennent de l’aubier, un traitement adapté à la classe d’emploi 3 (bois placé à l’extérieur mais non en contact avec le sol) est conseillé. Cependant, le duramen du Douglas est non imprégnable et celui de l’aubier moyennement à peu imprégnable. L’effet du traitement sur la durabilité conférée au bois sera donc limité…
-
Au printemps et en été, on nous signale régulièrement l’apparition de fentes et gerces dans les terrasses. Pourquoi et comment y remédier ?
Les fentes et gerces (fentes de taille plus réduites) sont le résultat du gonflement et du rétrécissement du bois. Le bois est un matériau hygroscopique. Lorsqu’il absorbe l’humidité de l’air ambiant, le bois se dilate. Et lorsqu’il rejette l’humidité dans l’environnement, il se rétracte. Le taux d’humidité du bois dépend directement du taux d’humidité relative de l’air dans lequel il est mis en œuvre. Dans un environnement devenant humide (où le taux d’humidité d’équilibre du bois est supérieur au taux d’humidité du bois avant le changement de conditions)), une planche absorbe l’humidité de l’air et gonfle. Lorsque le taux d’humidité diminue ensuite (le taux d’humidité d’équilibre du bois est inférieur au taux d’humidité du bois avant le changement de conditions), le bois se rétracte. Durant ces périodes de gonflement ou de rétrécissement, le bois risque de se déformer et/ou de se fissurer. Le bois utilisé en extérieur est constamment exposé aux variations de l’humidité de l’air (jour/nuit, hiver/été, pluie/sécheresse…) et est donc constamment ‘en mouvement’. En automne et en hiver, l’humidité est assez élevée mais reste relativement constante dans nos régions. Il est donc logique que les lames de terrasse en bois gonflent alors légèrement.
Au printemps et en été, l’humidité relative de l’air est plus faible et le temps plus sec. L’humidité est également beaucoup moins constante. Par ailleurs, les vents forts et secs venant de l’est sont plus fréquents. Lorsque plusieurs facteurs sont réunis (forts vents d’est, période chaude avec fort réchauffement par le soleil, etc.), le bois peut soudainement se dessécher fortement, ce qui augmente considérablement les risques de dommages sous forme de fentes ou gerces ou de déformations. Les fentes dues au vent qui se produisent aux extrémités des planches en sont un exemple typique. En automne, le bois s’humidifie et gonfle à nouveau, faisant ainsi ‘disparaître’ les petites fissures. Dans la réalité, elles subsistent mais elles sont rendues invisibles car leurs bords sont devenus jointifs. Les conséquences sont souvent irrémédiables et, dans ce cas, les lames fissurées ou déformées doivent être remplacées. En règle générale, les lames de terrasse ne sont pas séchées artificiellement. Cela signifie qu’au moment de la pose, le bois a un taux d’humidité d’environ 18-20%.
Conseils pratiques
Mieux vaut donc poser une terrasse en automne ou en hiver. De la sorte, le bois peut déjà s’équilibrer lentement avec l’humidité de l’air. Il est préférable de ne pas installer une terrasse pendant une période très sèche où le soleil ou le vent sont intenses. Notez aussi qu’il est important queait un taux d’humidité le plus proche possible de son taux d’humidité d’équilibre au moment de sa mise en œuvre. Ce taux est d’environ 14% en été et de 22% en hiver.
Le traitement des terrasses, par exemple avec une huile, réduit l’échange d’eau entre le bois et l’air. Cela peut donc contribuer à éviter la dilatation et le retrait du bois. Les taux d’humidité d’équilibre et les variations dimensionnelles peuvent être estimés à l’aide du module de calcul sur le site de Hout Info Bois, dans la section ‘Informations techniques’, puis ‘Matériaux’ et ‘L’eau et le bois’.
-
Pourquoi tant de confusion autour des appellations des espèces résineuses ?
Quand les architectes et les ingénieurs recherchent une espèce résineuse qui convient pour un usage spécifique, ils sont souvent confrontés au problème qu’une même espèce peut être commercialisée sous plusieurs appellations différentes.
Ainsi, il existe parfois des divergences entre les noms génériques et commerciaux et les noms qui font l’objet d’une appellation officielle et scientifique. Un bref aperçu est présenté ci-dessous :
Douglas : bois de l’espèce Douglas dont le nom latin est Pseudotsuga menziesii.
Oregon : il s’agit également du Pseudotsuga menziesii. Douglas et Oregon correspondent donc à la même espèce. L’Oregon est importé d’Amérique du Nord. Le Douglas, pour sa part, que nous rencontrons sur le marché provient principalement d’Europe.
Oregon Couronne : il s’agit également du Pseudotsuga menziesii. Un paquet d’Oregon Couronne est constitué de planche d’Oregon de la plus haute qualité.
Sapin : correspond au nom latin de l’espèce Abies alba ou communément aussi appelé sapin blanc, sapin pectiné ou sapin des Vosges. Cette espèce est très rarement présente en Belgique, son bois n’est d’ailleurs quasi pas commercialisé chez nous.
Mélèze : bois de l’espèce européenne de Mélèze (Larix decidua) ou du Mélèze du Japon (Larix kaempferi) qui croît également en Europe tout comme une espèce hybride de ces deux premières. Le bois de ces espèces est commercialisé indifféremment en Belgique sous le nom général Mélèze.
Pin : bois du Pin sylvestre (Pinus sylvestris), également commercialisé sous le nom ‘Sapin rouge du nord (SRN)‘ lorsqu’on fait référence au bois provenant de Scandinavie.
Epicéa : bois de l’épicéa (Picea abies) abusivement appelé aussi Sapin (étant donné que dans ce cas il s’agirait de l’Abies alba). Il est souvent commercialisé sous le nom ‘Sapin blanc du nord (SBN)’ mais dans ce cas, on fait référence au bois de provenance scandinave.
Pour les deux dernières espèces, l’appellation vernaculaire évoque la couleur du bois d’épicéa qui est blanche par opposition à celle du duramen du bois de pin sylvestre qui est rouge (son aubier étant blanc).
Afin d’éviter toute confusion, il est conseillé aux architectes d’inclure dans leurs cahiers des charges le nom vernaculaire de l’essence de bois, suivi du nom scientifique entre parenthèses.
-
Puis-je me fier au méranti qu’on me propose pour mes menuiseries extérieures ?
Le méranti est un nom commercial générique utilisé pour identifier les bois appartenant au genre Shorea issu de la famille des Dipterocarpacees. Il s’agit d’une très grande famille parmi laquelle le genre Shorea regroupe 196 espèces différentes !
Il existe 5 principaux groupes de méranti, principalement différenciés sur base de la couleur du duramen de l’espèce (notons que Lauan désigne en fait un méranti au sens large du terme dès lors qu’il est employé pour la fabrication de panneaux) :
Le premier groupe (dark red meranti) regroupe les espèces souvent les plus durables et dont les propriétés mécaniques moyennes sont meilleures.
A l’origine (il y a plus de 60 ans), l’espèce Shorea pauciflora était reconnue pour sa bonne durabilité naturelle (classe de durabilité naturelle 2) et ses excellentes propriétés mécaniques. Il s’agissait du méranti dit ‘Nemesu’ originaire des îles du sud-est de l’Asie, majoritairement de Malaisie (dans une moindre mesure des Philippines et d’Indonésie). Elle constituait l’essence phare des dark red meranti et abondait sur le marché européen. À la suite de la surexploitation de cette espèce (à ce jour, près de 75% des espèces de Shorea figurent sur la liste rouge – soit des espèces plus ou moins gravement menacées d’extinction – de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature), toutes sortes d’espèces du genre Shorea aux qualités et propriétés très variables sont utilisées et appelées sous le nom générique méranti. La classification en groupes évoqués plus haut n’a plus été respectée. Le marché s’est donc vu envahi d’espèces de classe de durabilité moindre, soit 3 voire 4 !! Leurs propriétés mécaniques étaient également très variables et souvent inférieures à celles de Shorea pauciflora.
Mesure de prudence
Cette variabilité de propriétés au sein d’une même dénomination génère beaucoup de confusions. Par mesure de prudence, il est vivement conseillé de ne plus se fier aux dénominations des groupes mais de n’employer que des Shorea dont la masse volumique est supérieure à 550 kg/m³. De ce fait, vous augmentez la probabilité d’avoir un bois aux propriétés mécaniques meilleures. De manière générale, il n’y a pas de lien entre les propriétés mécaniques et la durabilité naturelle. Pourtant, dans le cas des Shorea, avec un bois ayant cette densité minimum, on peut s’attendre à une meilleure durabilité !
Malheureusement, les bois de quasi toutes les espèces du genre Shorea se ressemblent à l’œil nu. Aucun revendeur ou transformateur professionnel ne peut donc les identifier avec certitude. Une telle identification requiert une observation au microscope et, même dans ce cas, ce n’est pas chose aisée ! Il existe en Belgique quelques rares laboratoires spécialisés qui peuvent réaliser de telles expertises.
En raison de la variabilité des propriétés de l’espèce, il est conseillé premièrement de se baser sur la masse volumique minimale requise de 550 kg/m³, de prendre comme référence, par sécurité, les qualités (durabilité, propriétés mécaniques, …) associées les plus faibles ou de choisir un autre bois dont l’appartenance à une espèce ne fait aucun doute.
-
Comment puis-je prévenir ou traiter une attaque d’insectes dans le parquet ou le bois de structure ?
Le bois peut faire l’objet d’attaques d’insectes et de champignons, même s’il n’est pas utilisé à l’extérieur et n’est donc pas exposé à la pluie. Il y a également un risque pour le bois utilisé à l’intérieur : escaliers, parquet, … En cas d’attaque d’insectes, le bois peut être dégradé par l’insecte adulte ou par les larves de certains insectes selon les espèces. L’attaque d’insectes peut être évitée de plusieurs façons.
-
- Traitement préventif. Selon la STS 04.3, un traitement de préservation selon le procédé A1 suffirait, bien que ce procédé ne soit jamais appliqué dans la pratique et soit immédiatement remplacé par le procédé A2.1. Ce traitement a toujours lieu dans une station de traitement spécialisée et agréée. En pratique, ce traitement est principalement, mais pas exclusivement, appliqué au bois de résineux afin de lui donner une meilleure protection contre les insectes et les champignons.
- Éviter l’utilisation de l’aubier, par exemple pour les parquets et les meubles, étant donné que l’aubier n’est jamais durable. Toutefois, le fait de n’utiliser que du duramen ne garantit rien : dans le cas d’un certain nombre d’essences de bois (non durables), le duramen peut également être attaqué !
- Action curative. S’il s’agit d’un élément structural en bois et que l’attaque se trouve probablement déjà à un stade bien avancé, il faut d’abord déterminer l’ampleur de l’attaque et vérifier si l’élément est encore apte à sa fonction structurale. L’étape suivante consiste à vérifier s’il s’agit bien d’une infection encore active. Les cavités dans un élément en bois peuvent très bien témoigner d’une infestation passée, sans que le bois contienne encore des insectes (ou larves) vivants. Toutefois, si l’on trouve de la poussière fraîche sous l’élément ou si l’on observe des insectes vivants, un traitement curatif est nécessaire. L’insecte doit ensuite être identifié par un laboratoire spécialisé. Sur base de cette identification, ainsi que de la nature et de l’étendue de l’attaque, le traitement curatif peut être effectué soit par une entreprise spécialisée, soit par le particulier.
En cas d’infestation grave, une entreprise spécialisée effectuera l’examen d’identification de l’insecte, qui procèdera également à un contrôle de la maison entière pour y détecter la présence d’insectes et/ou de larves. Les insectes seront ensuite détruits en traitant le bois avec un produit curatif et insecticide. Le bois voisin sera également traité préventivement pour éteindre l’infection. Enfin, les dommages seront réparés et/ou certains éléments bois seront remplacés.
Pour le bois de structure, nous vous conseillons toujours de faire préserver le bois de manière préventive pour éviter des futurs problèmes d’insectes ou de champignons.
-
-
Quelle réaction au feu doit atteindre un bardage en bois ?
La réaction au feu d’un matériau correspond à son niveau de combustibilité.
Il n’existe pas d’exigence pour les maisons individuelles en matière de réaction au feu.
Pour les autres bâtiments, les exigences réglementaires sont différentes en fonction de la hauteur du bâtiment. Elles sont les suivantes :Bâtiment bas (h<10m): D-s3, d0*
Bâtiment moyen (10<h<25m): b-s3, d1
Bâtiment haut (h=>25m): B-s3, d1*D correspond à l’Euroclasse de combustibilité du matériau (celle-ci va des classes A1 et A2 – matériaux incombustibles aux classes B, C, D, E – matériaux combustibles et F qui correspond aux matériaux non testés ou sans performance requise)
S correspond à la production de fumée (3 classes, s3 produisant beaucoup de fumée jusqu’à s0 qui ne produit pas de fumée)
d correspond à la production de gouttes (3 classes, d3 produisant beaucoup de gouttes jusqu’à à d0 qui ne produit pas de goutte)L’obtention d’une réaction au feu est relativement aisée car le classement par défaut d’un bardage en bois rainuré-langueté ou à clin est D-s2, d0. Des essais ont pu confirmer cette classe. Pour ce faire, il est nécessaire de respecter les conditions de l’essai, à savoir :
• le bardage ne peut être ajouré ;
• l’épaisseur minimale des lames est de 18mm ;
• la densité du bois est supérieure ou égale à 390kg/m³ (pour le cèdre avec une densité supérieure ou égale à 350kg/m³) ;
• une lame d’air ventilée est ménagée derrière les lames de bois ;
• enfin, étant donné que les performances de réaction au feu à atteindre ne concernent pas que le bois mais bien tout le complexe de la paroi, les matériaux mis en œuvre derrière la lame d’air (panneau, isolation) doivent être incombustibles (classe A2-s1, d0 ou mieux).
A l’heure actuelle, il existe quelques autres solutions pour les bardages devant atteindre la classe D-S3, d0 tant en pose fermée qu’en pose ajourée. Précisons toutefois que les solutions en pose ajourée sont relativement contraignantes et compliquées.
Pour les bâtiments moyens et hauts, un traitement ignifuge du bois est indispensable pour atteindre la réaction au feu B-s3, d1. Il faut bien le reconnaître, même dans le cas d’un bardage fermé, les solutions restent rares et compliquées. Quant aux mises en œuvre ajourées, il n’existe pas encore de solution. -
Comment obtenir un bardage de couleur grise homogène ?
Le phénomène de grisaillement du bois se produit lorsque le bois n’a pas reçu de traitement de finition. Le grisaillement est le fruit de l’action conjuguée de l’oxydation du bois par les rayons ultraviolets et du lessivage par la pluie.
Toute portion de bardage qui ne serait pas exposée de la même manière à ces deux facteurs présentera rapidement une couleur différente allant de la couleur initiale et naturelle du bois à la couleur gris argenté si caractéristique. Etant donné qu’une façade comporte souvent des zones d’ombre (comme sous une corniche, autour des fenêtres ou sous les seuils de fenêtre), un grisaillement homogène est pratiquement utopique.
Afin de pallier ce problème d’hétérogénéité, il existe toutefois sur le marché des saturateurs de couleur grise, sorte d’huile non filmogène, à appliquer au pinceau ou à la brosse en une ou deux couches (selon le niveau de gris recherché) avant ou après la pose du bardage. Ce type de produit confère au bois une couleur homogène artificielle grise. Par la suite, il n’est plus nécessaire d’appliquer une nouvelle couche de saturateur. Ainsi, les zones exposées grisailleront naturellement au fil du temps alors que les zones plus protégées conserveront leur couleur grise artificielle. Le résultat final sera donc un bardage de couleur grise et homogène.
-
Un client se plaint que son bardage en cèdre présente des taches foncées. Quelle en est la cause ? Et comment les éliminer ?
Si aucun traitement de finition n’est appliqué, le bois utilisé à l’extérieur se décolore sous l’influence des rayons UV (lumière du soleil) et de l’eau de pluie. En plus de ce vieillissement naturel du bois, des taches sombres peuvent apparaître à la surface du bardage. Ce type de coloration est dû à la migration de substances solubles présentent dans le bois. Une succession d’humidification et de séchage du revêtement peut provoquer l’accumulation de ces substance en surface et engendrer la formation de taches sombres. Un certain nombre d’essences sont relativement sensibles à ce type de décoloration, dont notamment le Western Red Cedar.
D’un point de vue esthétique, ces taches peuvent être indésirables. Il existe un traitement pour pallier ce problème. Des tests avec différents produits ont montré que le meilleur résultat était obtenu par un nettoyage profond du bardage à l’eau de javel diluée (150 ml/l d’eau). La manière la plus efficace est de le nettoyer manuellement avec une brosse. Dans une première étape, on brosse les planches énergiquement avec une solution d’eau de javel diluée. Ensuite, on brosse à nouveau mais uniquement à l’eau claire. Ce processus de nettoyage intensif n’éliminera pas toujours complètement les tachesmais elles seront certainement éclaircies. Dans certains cas, le traitement peut rendre le bois plus clair. Il est recommandé de tester la méthode sur une partie moins visible du bardage avant de traiter la façade complète. -
Piscine couverte : quelle essence ? Quel traitement ?
En tant qu’architecte auteur de projet d’une piscine couverte privée, je m’interroge sur le choix le plus judicieux de l’essence à prévoir pour des éléments de charpente en bois massif (fermes et pannes) ainsi que sur le type de traitement par imprégnation à leur réserver.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’environnement d’une piscine est généralement peu différent de celui d’une pièce intérieure classique. L’humidité relative de l’air est en général comprise entre 40 et 60%. Le risque pour l’emploi du matériau bois est donc très limité puisque son taux d’humidité d’équilibre sera compris entre 8 et 11% (pour rappel, en-dessous de 20% de taux d’humidité du bois, une attaque de champignon n’est pas possible). La classe d’emploi du bois sera donc 1 ou 2 (selon que le bois sera utilisé dans une structure respectivement de manière visible ou non.
Concernant l’essence, il s’agit le plus souvent, pour une utilisation en structure, d’espèces résineuses mais une espèce feuillue pourrait également convenir. En raison du faible risque d’attaque du bois, la classe de durabilité naturelle du bois a peu d’importance.
Bien évidemment, il est capital de prévoir une excellente isolation en évitant les ponts thermiques qui pourraient être source de condensation et par conséquent, à terme, de cause d’humidification anormale du bois. Une bonne ventilation limitera les risques de condensation également.
En outre, il est important d’éviter le contact du bois avec le sol et de prévoir une mise en œuvre (surélévation de la structure ou mesures de protection physique) qui évite l’humidification du matériau par projection lors du nettoyage ou des activités dans la piscine.
Une humidification temporaire (quelques heures) par projection d’eau n’aura aucun effet sur le matériau si ce n’est la possible apparition de taches sur le bois en raison de la migration de substances solubles présentes dans le bois. Pour éviter ou limiter ces taches, l’application d’un traitement de finition type huile sera très efficace pour limiter ces taches.
Le chlore est en concentration trop faible que pour agir sur le traitement ou le bois.
-
Bardage en cèdre rouge : comment éviter le grisaillement et conserver son aspect naturel ?
Nous sommes actuellement en train de faire construire une maison dont une partie de la façade est en bardage bois en cèdre rouge. Nous souhaitons que le bois conserve son aspect actuel (sans trop grisailler). Quel traitement de protection nous conseillez-vous? Quel produit faut-il appliquer ? En combien de couches? Dans combien de temps faudra t’il renouveler l’application? Quand procéder au premier traitement? Nous vous remercions de vos conseils.
Bonjour, Je vous suggère pour le traitement de votre cèdre un produit que nous nommerons A (pour plus d’informations, contactez-nous). Le produit ne peut pas s’appliquer de suite sur le cèdre, il faut attendre plusieurs mois voire un an. Entretemps, il faut laisser votre bois grisailler mais ne vous inquiétez pas, il existe un autre produit, appelons-le B qui lui redonnera sans problème sa couleur d’origine et qui est très facile à appliquer. Ensuite, vous appliquerez le produit A incolore en 2 à 3 couches. Attention, l’application se fait ‘humide sur humide’ (15 à 30 minutes d’intervalle). Il ne faut donc pas laisser sécher entre les couches. Il faut une bonne répartition du produit sur toute la surface mais pas d’excès par endroit car cela créerait un film qui serait un point de faiblesse. La réapplication dans le temps du produit dépend de l’exposition de votre bardage. Lorsque la couleur commence à changer, vous devez en ré-appliquer! La couleur finale obtenue avec le produit A correspondra à celle du bois lorsqu’il est mouillé c’est-à-dire légèrement plus foncé. -
Revêtement de sol en bois et chape
Nous souhaitons poser un nouveau parquet dans notre living. Nous sommes en train de démonter l’ancien revêtement de sol. Celui-ci reposait directement sur du sable. Nous avons creusé environ 15 cm de profondeur jusqu’à ce que l’ancien revêtement soit complètement ôté. Nous souhaiterions maintenant poser une chape munie d’une isolation. Le parquet fait 20mm d’épaisseur, avons-nous suffisamment d’épaisseur pour réaliser le tout avec 13 cm ? Quelle est la meilleure manière de réaliser ce travail ?
Les revêtements de sol en bois étant sensibles à l’humidité, il convient de tenir compte du risque d’humidité en provenance du support.
Il faut prévoir premièrement une membrane d’étanchéité situé sur sable ou terre-plein. Le chevauchement des bandes doit être de minimum 200mm. Sur les côtés de la pièce, le film est relevé d’au moins 5-6 cm sur les murs, il sera masqué par les plinthes.Idéalement, une dalle en béton (ciment, gravier, eau et armature métallique) doit venir couvrir cette membrane. Son épaisseur doit être de minimum 50 mm. En raison de la faible épaisseur disponible et si le support est toutefois stable, il ne sera possible de ne travailler qu’avec un isolant et une chape mais armée.
Dès lors, sur la membrane d’étanchéité, une isolation par exemple en polyuréthane de 30 mm peut être mise en œuvre. Ensuite, une chape renforcée (ciment, sable eau et armature métallique) de 80 mm d’épaisseur doit être coulée sur l’isolant. Le plancher peut être ensuite posé sur la chape en béton si cette dernière est sèche (max. 2.5% d’humidité). Le plancher sera cloué si son épaisseur fait de l’ordre de 20 mm (mais dans ce cas il faut prévoir une épaisseur supplémentaire pour la mise en œuvre d’un support clouable de type panneau ou lambourde) et collé si son épaisseur est de l’ordre de 14mm.
Idéalement, il faudrait prévoir la mise en œuvre suivante :
- Membrane d’étanchéité;
- dalle en béton (ciment, gravier, sable, eau et armature métallique) d’une épaisseur minimum de 50 mm;
- isolant (épaisseur variant selon le niveau d’isolation souhaité);
- chape (ciment, eau et sable);
- éventuellement une structure clouable (si l’épaisseur du plancher est supérieure à 20mm);
- un plancher collé (si l’épaisseur est de 14 mm.
Le pourcentage d’humidité relative des bois doit être compris entre 7 et 11% pour une humidité relative de l’air comprise entre 40 et 60% d’humidité à une température de 20°C.
-
Bow-Window : quelle essence?
L’oriel (bow-window) en meranti de notre living doit être remplacé en raison de la pourriture du bois à certains endroits du côté intérieur. Est-il possible de remplacer uniquement les pièces de bois endommagées et nous conseillez-vous plutôt du meranti ou de l’afzelia ?
Certains professionnels ont probablement plus d’expérience que d’autres dans les bow-windows mais tous les menuisiers sont à même de réaliser ce type de travaux sur des menuiseries extérieures. Dans le doute, demandez quelques exemples de réalisations à votre menuisier. D’un point de vue technique, toutes les pièces en bois présentant des marques de pourriture doivent être éliminées et remplacées. Il va de soi que ces travaux n’ont de sens qu’à partir du moment où la cause de la détérioration a pu être identifiée afin d’y remédier au préalable. Votre menuisier pourra certainement vous aider à déterminer l’origine du problème. Concernant l’espèce de bois, nous conseillons plutôt l’afzelia que le meranti car ce bois est plus durable (c’est-à-dire qu’il résiste mieux aux attaques de champignons) et plus stable. Veillez aussi à une bonne ventilation pour garantir une meilleure stabilité des éléments en bois. -
Bardage foncé : quelle lasure?
Nous aimerions réaliser un bardage en bois massif de teinte foncée. Quels sont les traitements envisageables ?
Il convient de se méfier des bardages foncés. En cas d’exposition aux rayons du soleil, la température du bois peut grimper jusqu’à 70°C, voire plus. Cette température élevée peut entraîner une déformation du bois et, s’il s’agit d’un résineux, des coulures de résine liquéfiée. Si vous tenez absolument à réaliser un bardage foncé, avec les risques de surchauffe que cela entraîne, différentes options s’offrent à vous. Tout d’abord, un traitement à l’huile naturelle foncée. Selon l’exposition, la périodicité de l’entretien varie entre 2 et 6 ans (l’exposition sud/sud-ouest étant la plus sollicitée). Autre possibilité, le bois thermo-traité. Plusieurs teintes de noir sont proposées. Plus le bois subit un traitement prolongé, plus la teinte sera foncée. L’inconvénient est que le bois peut grisailler avec le temps, il convient donc de lui apporter un traitement de finition (par exemple avec une lasure ou une huile) pour conserver sa couleur. Côté avantages, ce traitement rend le bois très stable et est aussi possible avec des bois feuillus, même locaux comme le peuplier, le frêne ou le hêtre (ce qui écarte le risque de coulure de résine). Le bois traité à la chaleur acquiert une classe de durabilité 1 (la meilleure). -
Le mélèze en bardage: les risques de déformation?
Nous sommes en train de réaliser un bardage extérieur en mélèze. Les cadres de fenêtres sont aujourd’hui également prévus en mélèze de 40 mm d’épaisseur et 200 mm de large. Nous nous demandons si ces cadres en mélèze de section 200×40 mm ne risquent pas de se tordre ou de trop travailler?
Le risque de déformation n’est jamais nul… Surtout avec le mélèze qui est un bois nerveux. Le douglas eut été préférable car esthétiquement très ressemblant et moins nerveux.
Cependant, le facteur d’élancement (rapport de la largeur sur l’épaisseur) est de 5, ce qui est favorable. Pour un bardage, on estime que si le facteur d’élancement est inférieur à 8, les risques de déformations sont diminués. Si c’est encore possible, la stabilité des planches pourrait être accrue si des fentes de détensionnement sont produites sur la longueur de la planche, à l’arrière de celle-ci (deux fentes parallèles par planche d’une profondeur de +-1 cm et d’une largeur de 4 à 6 mm).
Avec un traitement de finition (type lasure), les risques de reprise d’humidité seront limités et par conséquent la stabilité meilleure. -
Bardage carbonisé : Solution écologique, esthétique et durable dans le temps ?
Je cherche à poser un bardage très foncé. J’ai fait des recherches sur une technique japonaise de carbonisation en surface du bois.
Des tests faits sur une planche de douglas donnent, à première vue, des résultats très positifs. Est-ce que vous avez des informations – conseils à donner sur cette technique? Avez-vous des données sur les impacts environnementaux de ce type de traitement? Comment faire pour éviter l’érosion de la partie carbonisée?
D’après nos connaissances, ce type de bardage ne grisaille pas. La couleur noire est donc maintenue. Cependant, certains traitements par carbonisation sont plus ou moins complets et carbonisent plus ou moins la surface des lames. Lorsque le traitement est partiel, il reste une partie de la lignine du bois qui est exposée et celle-ci peut encore grisailler sous l’influence des rayons UV rendant ainsi le bois plus clair.
Le traitement rend la surface du bois très durable. Utilisé en bardage, le bois n’étant pas sollicité mécaniquement, il va conserver ses propriétés et il n’y a pas de risque d’érosion.
Concernant l’impact environnemental, il est difficile de le déterminer, nous ne connaissons pas d’analyse de cycle de vie à ce sujet. Cependant, le traitement n’est qu’un chauffage à la flamme durant une dizaine de minutes. L’impact est donc faible mais comparativement à un bois non traité, il est évidemment plus important. Or, le douglas (hors aubier) est naturellement durable pour être utilisé, sans traitement, en bardage. Par contre, dans ce cas, il grisaillera. Si l’effet noir est recherché, la carbonisation est sans doute une excellente manière de le traiter. La peinture noire en est une autre, mais elle doit être réappliquée tous les +- 10 ans et elle n’est jamais conseillée car elle provoque, sous l’effet des rayons solaires, un échauffement du bois qui est de nature à le déformer ou provoquer une exsudation de résine.
-
Comment puis-je prévenir ou traiter une infestation d’insectes dans le parquet ou le bois de structure ?
Le bois peut être infesté par des insectes et des champignons, même s’il n’est pas utilisé à l’extérieur et n’est donc pas exposé aux éléments (l’humidité, par exemple). Certes, il y a également un risque pour le bois utilisé à l’intérieur, comme les escaliers, le parquet, … En cas d’infestation d’insectes, le bois peut être dégradé à la fois par l’insecte adulte et par les larves d’insectes. L’infestation par insectes peut être évitée de plusieurs façons.
La première méthode est de traiter le bois de manière préventive. Selon la STS 04.3, un traitement de préservation selon le procédé A1 suffirait, bien que ce procédé ne soit jamais appliqué dans la pratique, et soit immédiatement remplacé par le procédé A2.1. Ce traitement a toujours lieu dans une station de traitement spécialisée et agréée. En pratique, ce traitement est principalement, mais pas exclusivement, appliqué au bois de résineux afin de lui donner une meilleure protection contre les insectes et les champignons.
Une deuxième façon de réduire le risque d’attaque par insectes consiste à éviter l’utilisation du bois d’aubier, par exemple pour parquets et meubles, étant donné que l’aubier n’est jamais durable. Toutefois, le fait de n’utiliser que du duramen ne garantit rien : dans le cas d’un certain nombre d’essences bois (non durables), le duramen peut également être affecté !
Si vous constatez que votre parquet ou un chevron est atteint, une action curative peut être nécessaire pour limiter les dégâts. S’il s’agit d’un élément structurel en bois et que l’attaque se trouve probablement déjà dans un stade bien avancée, il faut d’abord déterminer l’ampleur de l’attaque et vérifier si l’élément est encore apte à sa fonction structurelle. L’étape suivante consiste à vérifier s’il s’agit bien d’une infection active. Les cavités dans un élément en bois peuvent très bien témoigner d’une infestation ultérieure, sans que le bois contienne encore des insectes vivants. Toutefois, si l’on trouve de la poussière fraîche sous l’élément ou si l’on observe des insectes vivants, un traitement curatif est nécessaire. L’insecte doit ensuite être identifié par un laboratoire spécialisé. A base de cette identification, ainsi que de la nature et de l’étendue de l’infestation, le traitement curatif peut être effectué soit par une entreprise spécialisée, soit par le particulier-même. En cas d’infestation grave, une entreprise spécialisée effectuera l’examen d’identification de l’insecte, qui procèdera également à un contrôle de la maison entière pour y détecter la présence d’insectes et/ou de larves. Les insectes seront ensuite détruits en traitant le bois avec un produit curatif et insecticide. Le bois voisin sera également traité préventivement pour éteindre l’infection. Enfin, les dommages seront réparés et/ou certains éléments bois seront remplacés.
Pour le bois de structure, nous vous conseillons toujours de faire préserver le bois de manière préventive pour éviter des futurs problèmes d’insectes ou de champignons.