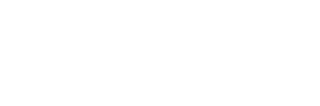Bois de construction
Le bois de structure
Le bois de construction, aussi appelé bois de structure, est un matériau naturel, durable et performant, utilisé depuis des siècles pour bâtir des maisons, réaliser des charpentes, des toitures, des éléments d’ossatures bois, etc. Quel matériau choisir pour la réalisation d’une toiture, par exemple ?
La plupart des concepteurs et des entrepreneurs optent pour le bois depuis la nuit des temps. À juste titre ! Le bois de construction a évolué et s’est diversifié, ces dernières décennies, de manière à offrir des perspectives plus que prometteuses. Le bois de construction — qu’il soit résineux, lamellé-collé ou reconstitué — demeure un matériau de choix pour les projets d’architecture durable. Grâce à la technologie, aux normes CE et aux procédés de transformation et d’ingénierie modernes, il offre solidité, esthétique et durabilité. Découvrez les différentes essences, les normes, les traitements et les technologies modernes qui font du bois un allié de choix pour vos projets de construction, qu’il s’agisse d’ossature bois, de charpente traditionnelle ou de structures innovantes.

Quels sont les bois de construction les plus utilisés ?
Bois résineux pour le bois de construction
Les bois de construction sont principalement des essences résineuses, reconnues pour leur légèreté, leur résistance et leur excellent rapport qualité/prix. Ils sont également les plus utilisés dans les projets d’ossature bois pour leur grande stabilité et leur facilité de mise en œuvre.
Les principales essences de bois de construction utilisées :
- du douglas d’Europe, en provenance de France, d’Allemagne et de Belgique ou de l’Oregon pine, en provenance d’Amérique du Nord ; (Pseudotsuga menziesii) ;
- de l’épicéa de Belgique et des pays limitrophes et l’épicéa du Nord, en provenance de l’Europe du Nord (Picea abies) ;
- du pin sylvestre (Pinus sylvestris), de Belgique et/ou des pays limitrophes ainsi que de l’Europe du Nord.
En résumé, par ordre d’importance il s’agit d’épicéa, de pin sylvestre ou de Douglas. Le mélèze est utilisé dans une moindre mesure.
Les avantages des essences résineuses
Les essences résineuses ont l’avantage de présenter un excellent rapport propriétés mécaniques/masse volumique mais également qualité / prix. En outre, elles sont abondantes dans nos forêts. Leur provenance est le plus souvent européenne et leur exploitation ne présente, à ce jour, aucun danger pour leur pérennité. Ces bois conviennent parfaitement à la réalisation d’ossatures bois performantes et durables.
Provenance et consommation des bois résineux en Belgique
La totalité des bois ronds résineux transformés en Belgique est consommée. Néanmoins, notre consommation est encore supérieure et il est indispensable d’importer des bois. L’origine de ceux-ci est principalement scandinave. Depuis la guerre entra Russie et l’Ukraine, plus aucun bois de Russie, pays auparavant très pourvoyeur de bois résineux, n’est importé sur le marché européen.
Les quantités importées sont largement supérieures aux quantités locales. Ceci explique, entre autres, les raisons pour lesquelles on parle encore trop souvent de ‘Sapin Rouge du Nord’ ou ‘SRN’ à la place de pin sylvestre, voire de ‘Sapin Blanc du Nord’ ou ‘SBN’ au lieu d’épicéa. Ces appellations sont abusives et interdites dans un cahier de charge public car elles désignent une provenance. À l’origine, l’utilisation de ces noms permettait de s’assurer de prescrire des bois séchés car les scandinaves séchaient tous leurs bois à l’inverse des producteurs belges.
Afin d’éviter toutes confusions, il est préférable de se référer à la NBN 13556 :2003 « Bois ronds et bois sciés – Nomenclature des bois utilisés en Europe » et d’utiliser en lieu et place des noms vernaculaires, le nom latin de l’espèce de bois.
À savoir :
- Pin sylvestre = Pinus sylvestris (code PNSY)
- Epicéa = Picea abies (code PCAB)
- Douglas = Pseudotsuga menziesii (code PSMN)
- Mélèze = Larix spp (code LADC pour Larix decidua et LAKM pour Larix kaempferi)
La performance des bois d’origine belge par rapport aux bois d’origine scandinave
Les bois scandinaves sont réputés pour avoir des cernes d’accroissement plus fins ce qui leur confère, en général, de meilleures performances mécaniques car les conditions dans lesquelles ils ont crû sont plus rigoureuses.
Depuis l’obligation de classer et de marquer tous les bois de structure depuis le 1/1/2012, ce type de considération n’a plus aucune raison d’être pour autant qu’elle en ait eu. En effet, il existe au niveau européen des systèmes de classement des bois, visuels ou mécaniques, qui détermine précisément la classe de résistance en flexion de chaque bois. Un bois sera classé par exemple C18 (résistance caractéristique de rupture en flexion = 18 N/mm²) quelle que soit sa provenance si ses défauts et particularités ne permettent pas de mieux le classer.


Le marquage CE des bois de structure
L’obligation de marquage des bois de structure à section rectangulaire au 1er janvier 2012 (marquage CE des bois de structure à section rectangulaire), permet de définir de manière rigoureuse une classe de résistance mécanique à chaque bois et homogénéisera les produits vendus sur le marché et destinés à de la structure.
👉🏽 En savoir plus sur le marquage CE du bois de construction
De quels paramètres dépend le choix de l’espèce pour du bois de construction ?
Le choix de l’espèce dépend de différents paramètres : la résistance mécanique, la durabilité, la résistance au feu
La résistance mécanique
Depuis le 1er janvier 2012, la norme NBN EN 14081 est la référence pour le marquage CE du bois de structure. Les bois feuillus doivent présenter un module d’élasticité d’au moins 9000 N/mm² et une stabilité dimensionnelle suffisante. Le marquage CE permet d’objectiver la qualité des bois mais également le dimensionnement des structures en bois. Cette norme est essentielle dans le calcul des éléments porteurs d’une ossature bois performante.
👉🏽 Découvrez nos logiciels de calcul des structures en bois.
La durabilité
Le bois de toiture n’entre pas en contact avec le sol, n’est pas exposé aux intempéries ni au délavage et n’est humidifié qu’accidentellement et temporairement (classe d’emploi 2 selon la norme NBN EN 335). Les insectes et l’humidité constituent les principales menaces. Les résineux doivent donc être préservés suivant le procédé A2.1. Cette préservation n’est pas nécessaire pour les bois feuillus à condition que les sections soient exemptes d’aubier et que l’espèce soit de classe de durabilité naturelle III ou mieux. Si les bois de charpenterie sont mis en œuvre et qu’ils restent visibles, la classe d’emploi des bois est alors 1 et les bois doivent être traités selon le procédé A1. Cette norme est essentielle dans le calcul des éléments porteurs d’une ossature bois moderne et performante.
La résistance au feu
La résistance au feu caractérise la capacité d’un élément de construction à conserver, durant une durée déterminée, la stabilité au feu (R), l’étanchéité au feu (E) et l’isolation thermique (I).
Le bois, bien que combustible, offre une bonne résistance au feu grâce à sa combustion lente et prévisible. Cette résistance peut être calculée selon la norme EN 1995-1-2, sans nécessiter d’essais coûteux. Les vitesses de combustion du bois sont les suivantes :
- 0,8 mm/min pour les résineux,
- 0,7 mm/min pour le bois lamellé-collé résineux,
- 0,55 mm/min pour le chêne.
La résistance au feu dépend de la section résiduelle de la poutre après carbonisation. Des formules permettent de calculer la largeur minimale nécessaire pour atteindre une résistance au feu donnée, en tenant compte de la hauteur, de la largeur, du temps d’exposition au feu et du type de bois.
Des tableaux de l’article PDF sur la résistance au feu des poutres en bois récapitulent les largeurs minimales pour différentes durées de résistance au feu (30 min, 1 h, 2 h) pour les planchers et les toitures, selon le type de bois et le rapport hauteur/largeur. Ces règles permettent d’assurer la stabilité des structures bois en cas d’incendie, tout en restant économiques.
Charpentes en bois : charpentes traditionnelles versus charpentes industrialisées
Bois de structure et charpente traditionnelle
La charpente traditionnelle, comme son nom l’indique, est le système que les charpentiers utilisaient dans le temps pour réaliser une toiture. Actuellement, elle est encore utilisée en restauration mais aussi en construction neuve lorsque le maître d’œuvre désire laisser des fermes apparentes.
D’autre part, le choix d’une charpente traditionnelle est parfois obligatoire pour des raisons techniques d’optimalisation de la surface habitable. Il n’est dès lors pas étonnant que l’architecte utilise ce système mais celui-ci est tenu de prévenir son client à temps, à cause du surcoût éventuel que ce choix peut engendrer.

Bois de construction : quels sont les avantages de la charpente traditionnelle ?
- Charme de la charpente apparente
- Liberté de modifier le cloisonnement intérieur
- Surface totale du grenier habitable
- Système toujours réalisable à condition d’avoir des points d’appui résistants pour la reprise de charge ponctuelle
Bois de construction : quels sont les désavantages de la charpente traditionnelle ?
- Si la charpente est construite sur chantier, sa réalisation est longue (mais actuellement, de plus en plus de charpentes traditionnelles sont aussi préfabriquées en atelier)
- Utilisation de sections importantes



Les composants de la charpente en bois traditionnelle
Utilisée en restauration ou construction neuve pour son charme et sa robustesse, la charpente traditionnelle se compose de :
- fermes
- pannes
- chevrons
- contre-lattes
- liteaux
La ferme est un ensemble de pièces de bois qui constitue un élément de charpente supportant le poids de la couverture. Elle est en général de forme triangulaire. Les fermes sont reliées entre-elles par des pannes.
Tant pour les combles aménageables que non aménageables, les espèces (résineuses) courantes disponibles dans le commerce conviennent pour les charpentes. Tenez compte de la poussée latérale sur les points d’appui, des contreventements, de la transmission des efforts au gros œuvre et des assemblages utilisés. Un calcul sur mesure n’est pas superflu.
Pannes : dans le cas d’une toiture inclinée, l’orientation, l’inclinaison et les matériaux utilisés déterminent la section de bois qui se prête le mieux aux pannes. Pour connaître la distance maximale à maintenir entre les pannes, utilisez le logiciel de calcul pour le dimensionnement des toitures inclinées établit sur la base de l’Eurocode 5 et ENV 1995-1-1
Chevrons : les chevrons, la sous-toiture, les contre-lattes et les liteaux assurent le soutien de la toiture. Quelles sont les dimensions requises pour les chevrons en fonction de la distance maximale entre les pannes ? Le logiciel de calcul vous permettra de les pré-dimensionner.
Contre-lattes : sur la sous-toiture, des contre-lattes sont appliquées parallèlement aux chevrons. Étant donné qu’elles sont en principe supportées sur toute la longueur par les chevrons, leur section n’est pas définie en fonction de leur force portante, mais de la hauteur nécessaire pour assurer une bonne ventilation, une évacuation efficace de l’eau et de la poussière dans la sous-toiture. Suivant les Notes d’Information technique du CSTC, la hauteur des contre-lattes doit se situer entre 15 et 26 mm. Elles auront de préférence 30 mm de largeur ou plus, de façon à éviter que le bois ne se fende au clouage.
Liteaux : les liteaux sont calculés en fonction du poids des tuiles et de l’entre-axe des chevrons de support.


Bois de construction et fermes industrialisées
Les charpentes industrialisées en bois sont des éléments structurels composés d’un ensemble de fermettes. La charpente réalisée au moyen de fermettes industrialisées est basée sur la pose de ces éléments de manière répétitive sur la sablière du bâtiment à construire. Les fermettes remplacent les pannes et les chevrons traditionnels. La liaison des fermettes entre elles est assurée par des dispositifs de contreventement. Les fermettes sont constituées d’éléments en bois de petite section et ayant reçu un traitement de préservation. Les éléments sont assemblés au moyen de connecteurs métalliques. Ces connecteurs, produits en perforant une plaque métallique de façon à obtenir des extrémités pointues qui se dressent et qui s’ancrent solidement dans le bois lors de l’assemblage, sont appliqués de façon parfaitement symétrique des deux côtés de l’assemblage à réaliser. Le certificat ATG garantit non seulement la qualité et le respect des normes de production et d’installation, mais également la résistance à l’arrachement et au cisaillement des connecteurs.
Les charpentes industrialisées présentent de nombreux avantages :
- préfabrication contrôlée (assemblage, préservation, tolérances admises, entreposage, transport) ;
- montage rapide ;
- convient pour divers types de toitures, avec combles aménageables ou non ;
- convient pour des toitures très complexes ;
- placement répétitif de sections relativement réduites possible avec une distance d’axe en axe de 40 à 60 cm.

Bois de construction : quels sont les avantages de la charpente industrialisée ?
- Préfabrication
- Plans de poses précis et complets
- Pas de déchets sur le chantier
- Liberté de modifier le cloisonnement intérieur
- Coût exact connu dès le devis
- Durée de pose sur chantier très courte
- Économie de matières premières car les éléments sont de section faible et le découpage est informatisé et optimalisé par calcul en atelier
Bois de construction : quels sont les désavantages de la charpente industrialisée?
- Invisible
- Nécessité d’utiliser du matériel lourd (grue) lors du montage sur chantier
- Perte d’espace induite par les nombreux éléments de triangulation
- Pas toujours réalisable en Belgique et ce, à cause des règlements d’urbanisme qui définissent la hauteur maximale sous corniche à mi-niveau du premier étage
Bois de construction et panneaux de toiture préfabriqués
Il s’agit d’une alternative aux deux systèmes précédents. Dans le cas de panneaux de toiture préfabriqués, les chevrons, l’isolation entre les chevrons et le voligeage de la face inférieure et supérieure sont assemblés en un ensemble. Il existe différentes techniques d’assemblage : le pistolage à froid au moyen de mousse isolante avec, comme finition, un profil appliqué sur la face inférieure ou le profilage des chevrons de rive, combiné ou non avec l’insertion d’un tasseau.
L’offre de panneaux de toiture préfabriqués est vaste. Tant les panneaux de la face inférieure que supérieure permettent l’intégration de divers matériaux et degrés de finition. Des solutions acoustiques ou ignifuges sont également possibles. Les panneaux de toiture préfabriqués représentent un gain de temps considérable, car vous pouvez poser simultanément la structure, l’isolation et la finition, ce qui réduit aussi au minimum les erreurs de mise en œuvre.
Ces solutions s’intègrent aisément dans des constructions à ossature bois, combinant légèreté, performance thermique et rapidité de montage.
Bois de construction et bois d’ingénierie
Quelles solutions technologiques pour une construction bois plus performante ?
Les toitures traditionnelles sont bien sûr toujours d’actualité. Mais elles ont leurs limites, notamment en raison des dimensions standard des bois massifs.
👉🏽 Consultez notre page des tableaux de dimensions des bois.
Les assemblages par exemple (clouage, boulonnage…) déterminent souvent la section de bois nécessaire. Les dimensions maximales disponibles dans les négoces de bois ou les scieries sont en outre généralement limitées à sept mètres. La construction d’une toiture classique requiert aussi de nombreuses heures de travail sur chantier et dépend des conditions météorologiques. L’usage de produits d’ingénierie est également de plus en plus fréquent dans les constructions à ossature bois, permettant de concevoir des bâtiments alliant résistance, durabilité et design contemporain.
Le secteur du bois a donc pallié ces inconvénients avec une série de développements dans le domaine du bois de construction :
Bois lamellé-collé
La technique du bois lamellé-collé consiste à assembler des lamelles de bois et à les coller. Cette technique existe depuis plusieurs siècles déjà. Elle permet des portées jusqu’à 150 mètres (en plusieurs poutres lamellées-collées et assemblées ayant une longueur chacune d’environ 45 m !) et des structures géométriques complexes.





Le bois lamellé-collé présente de nombreux avantages :
- Qualité uniforme : les défauts et les imperfections sont éliminés en réassemblant les éléments de bois ;
- Haute résistance au feu des éléments de section massive ;
- Rapport favorable entre solidité et poids propre ;
- Transport aisé ;
- Bonne résistance aux matières agressives (substances chimiques).
Le bois lamellé-collé peut également être utilisé à l’extérieur. Il doit toutefois être protégé au préalable architecturalement, par un débordement de part et d’autre de la poutre par exemple. L’espèce de bois utilisée doit aussi être suffisamment durable (classe de durabilité I à III). Si ce n’est pas le cas, il est conseillé d’appliquer un traitement de préservation selon le procédé A3. Les applications extérieures avec du bois lamellé-collé exigent une bonne finition et un entretien régulier.
Pour en savoir plus, consultez notre article du bois lamellé-collé (PDF).
Bois reconstitué
Le bois reconstitué, proche du LVL (Laminated Veneer Lumber) et de l’OSB par sa fabrication, occupe une place croissante dans la construction. Il s’agit d’éléments structuraux fabriqués à partir de petits morceaux de bois, souvent issus de forêts de plantation, qui sont triés, réassemblés et collés pour former des composants homogènes et performants. Cette technique permet :
- d’améliorer les propriétés mécaniques du bois,
- d’éliminer les défauts naturels,
- d’optimiser l’utilisation de la ressource forestière,
- tout en apportant une valeur ajoutée à des matières premières de moindre qualité.
Trois produits phares sont présentés :
- TJI® : poutrelle en I composée de membrures en LVL et d’une âme en OSB, légère, stable, disponible en grandes longueurs, idéale pour les planchers et charpentes.
- Parallam® (PSL) : poutre pleine constituée de longues lamelles parallèles, offrant une grande homogénéité et une résistance mécanique supérieure au bois massif, adaptée aux fortes charges et grandes portées.
- Intrallam® (LSL) : similaire au Parallam® mais avec des lamelles plus courtes et moins alignées, fabriqué à partir de peuplier tremble, apprécié pour sa stabilité, ses qualités esthétiques et son usage en menuiserie.
Le bois reconstitué répond aux critiques traditionnelles faites au bois (variabilité, instabilité, vulnérabilité) grâce à des procédés industriels contrôlés qui garantissent des performances constantes. Il permet aussi une utilisation plus rationnelle de la ressource forestière, en valorisant de petits arbres et en réduisant les déchets.
En conclusion, le bois reconstitué représente une avancée majeure pour la filière bois, conciliant exigences techniques, écologiques et économiques, et contribuant à une meilleure gestion des forêts tout en offrant des solutions innovantes pour la construction moderne.
Bois de construction et nécessité de préservation
Avant sa mise en œuvre sur chantier, le bois de charpente doit recevoir un traitement préventif contre les attaques d’insectes et de champignons (procédé A2.1). Ce traitement s’applique aussi aux structures d’ossature bois, afin d’assurer leur résistance et leur stabilité dans le temps.
Cette préservation doit être réalisée dans une station disposant d’un agrément technique. La station doit attester le traitement par un certificat joint à la facture ou au bon de livraison. Si le bois entre en contact avec une toiture métallique par exemple, il est conseillé de suivre les règles de prévention. Si les bois de charpenterie sont mis en œuvre et qu’ils restent visibles, la classe d’emploi des bois est alors 1 et les bois doivent être traités selon le procédé A1.
La préservation préalable n’est pas nécessaire pour les bois exempts d’aubier (en pratique, cette situation est très rare) et appartenant à une espèce dont la classe de durabilité naturelle est 3, 2 ou 1.
👉🏽 Pour en savoir plus, consultez notre page sur la préservation du bois et sur l’article PDF sur la corrosion des métaux par le bois.
Essences liées
- Applications
- Aménagement intérieur
- Bois de construction
- Bois de jardin
- Bois de terrasse
- Collage
- Construction en bois
- Escaliers
- Menuiserie extérieure
- Panneaux
- Plans de travail en bois massif
- Portails en bois
- Portes intérieures
- Revêtement de façades
- Revêtement de parois en bois
- Revêtement de plafond en bois
- Sols en bois